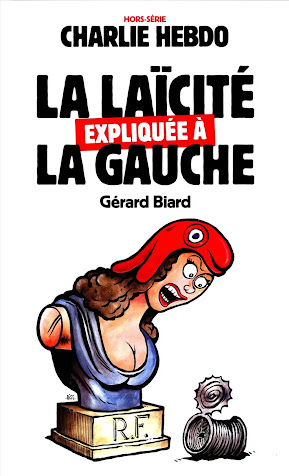Dans un arrêt Paul Getty Trust et autres c. Italie du 2 mai 2024, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) estime que le droit que possède l'État sur son patrimoine historique et artistique peut être protégé sur le fondement de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, celui-là même qui garantit le droit de propriété.
Elle considère conforme à ces dispositions la décision italienne de confiscation d'une statue de bronze, "Le jeune vainqueur", attribuée à Lysippe (300 av. J. C.). Cette oeuvre avait été retrouvée à l’été 1964 dans la mer au
large de Fano sur la côte adriatique de l’Italie, accrochée dans les
filets d’un chalutier italien. Volée dès l'année suivante, elle est retrouvée à Munich en 1972, aux mains d'un acheteur privé, M. H. H. Alors même qu'aucune autorisation d'exportation n'avait jamais été donnée, les démarches entreprises par l'Italie sont demeurées sans résultat, car H. H. refuse toute visite d'un expert, ou même seulement d'un photographe. Quant aux juges allemands, ils écartent toutes les demandes de coopération formulées par autorités italiennes. En 1977, le Paul Getty Trust achète le bronze à M. H. H., pour 3 900 000 €. Cette fois, l'oeuvre quitte l'Europe pour être exposée à la Villa Getty de Malibu. Les autorités italiennes ont considéré que, faisant partie du patrimoine culturel italien, elle avait été exportée sans autorisation et donc de manière illicite.
La procédure de confiscation occupe une vingtaine de pages de l'arrêt de la Cour. Les Trustees, comme les autorités américaines, et comme les juges américains, ont tout fait pour s'opposer à la revendication italienne. Le Paul Getty Trust obtient ainsi de la Cour de cassation italienne l'annulation d'une première décision de confiscation, pour défaut d'enquête publique. Une seconde a été prise, et la Cour de cassation a admis sa légalité en 2019. A ses yeux, le Paul Getty Trust a commis une faute en ne se renseignant pas sur l'origine de la statue, et sur le respect, ou non, des formalités liées à son exportation. Le Trust conteste donc cette décision devant la CEDH, en invoquant son droit de propriété sur ce bien culturel.
La compétence italienne
La première question posée à la Cour est celle de la compétence des autorités italiennes pour prendre une décision de confiscation dont le destinataire est une personne privée de droit américain. Certes, la juridiction d'un État s'étend d'abord sur son territoire, mais la CEDH reconnait que, par exception au principe de territorialité, ses décisions peuvent produire des effets hors de son territoire. En matière d'extradition, la Cour considère ainsi que, bien que
l'individu se trouve sous le contrôle de l'État requis, la privation de
liberté trouve son origine dans une décision de l'État requérant, en
application de conventions où ils sont tous les deux parties. Dans sa décision Stephens c. Malte de 2009, elle affirme donc que l'État requérant doit garantir que la détention d'un individu en attente d'extradition est compatible avec son droit national et avec la Convention d'extradition.
Dans l'affaire du "jeune vainqueur", la Cour doit s'assurer que l'Italie peut être tenue responsable, au sens de la Convention européenne, de l'exécution de la décision de confiscation. L'arrêt Toniolo c. Saint-Marin et Italie du 26 juin 2012 affirmait déjà qu'un acte pris par un pays requérant sur le fondement de son droit interne, et suivi par le pays requis en réponse à ses obligations conventionnelles, pouvait être considéré comme relevant de la juridiction du pays requérant. En adressant une demande de coopération judiciaire pour faire exécuter sa décision de confiscation, l'Italie devait donc veiller à ce que celle-ci soit conforme à la Convention européenne. La mesure dont se plaint le Paul Getty Trust peut donc être contestée sur le fondement de l'article 1er du Protocole n° 1, l'Italie se voyant accusée d'une violation du droit de propriété.
Le Jeune Vainqueur, attribué à Lysippe. IIIè s. av J. C.
L'atteinte au droit de propriété
Aux termes de la Convention européenne, l'ingérence dans le droit de propriété est licite si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un but d'intérêt général, et enfin si elle est proportionnée au but poursuivi.
Nul ne conteste que la loi italienne comporte une procédure d'interdiction d'exportation des oeuvres artistiques ou historiques, dans un but de protection du patrimoine. Et précisément, c'est même l'apport essentiel de la décision du 2 mai 2024, la CEDH affirme clairement que ce but est d'intérêt général.
Elle rappelle que la Convention ne saurait être interprétée sans tenir compte des principes du droit international. En l'espèce on ne manque pas normes internationales, et la Cour les mentionne largement, énumérant les instruments destinés à lutter contre l'exportation illicite des biens culturels. De la Convention de l'Unesco de 1970 concernant les mesures à prendre pour empêcher les transferts de propriété illicite de biens culturels à la Convention Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés, en passant par la directive européenne du 15 mai 204 relative à la restitution des biens culturels, tous ces textes confirment la légitimité de la revendication italienne. La CEDH s'appuie sur cette série de textes pour affirmer cette conformité à la Convention de l'action italienne visant à la restitution de biens culturels et artistiques. Et la Cour ne manque pas d'affirmer que l'objet ultime demeure, dans tous les cas, de permettre aux visiteurs d'un musée de l'admirer.
L'analyse devient très sévère, lorsque la Cour s'interroge sur la proportionnalité de la demande italienne au regard des buts poursuivis. Le Paul Getty Trust n'est pas épargné par les juges européens qui déclarent qu'il a "au minimum fait preuve de négligence". La formule semble indulgente, si l'on considère la liste des reproches formulés à son égard. Ainsi, en 1977, au moment même où il achetait le bronze, il aurait dû s'interroger, et, pour le moins, avoir des doutes sur sa provenance. A l'époque en effet, l'Italie avait engagé une action contre le propriétaire, M. H. H., demeurant à Münich. Il n'est guère pensable que les nombreux avocats et les trustees du Paul Getty Trust aient été dans l'ignorance de ce contentieux. Or, apparemment, ils ont cru, ou fait semblant de croire, l'assertion du vendeur qui déclarait savoir "de bonne source" que l'Italie ne contesterait pas la transaction.
C'est sur cette base que le Paul Getty Trust invoque sa bonne foi, et que la CEDH constate, au contraire, "qu'il a fait preuve de négligence, pour ne pas dire de mauvaise foi". Certes la mauvaise foi n'est évoquée que comme une hypothèse plausible, mais elle est mentionnée, et certainement pas par hasard. De fait, la Cour estime que les efforts de l'Italie pour récupérer un bien illégalement exporté justifient pleinement l'acte de confiscation.
La décision est rude pour le Trust requérant, mais on ne peut que se féliciter de l'aide qu'apporte la Cour aux procédures de restitution des biens volés ou illégalement exportés. La décision présente ainsi plusieurs points positifs. D'abord, le droit de la convention européen vient renforcer un droit international qui, dans ce domaine, est très largement dépourvu de voies de recours. Ensuite, elle refuse d'entrer dans la discussion sur le temps qui passe. On sait en effet qu'un bien volé va généralement être vendu, puis revendu à plusieurs reprises, sa cote approchant, au fil des transactions, celle d'un bien acquis légalement. Le dernier acheteur peut alors invoquer la bonne foi pour écarter sa responsabilité. En l'espèce, le Paul Getty Trust n'est pas de bonne foi, alors qu'il a acheté en 1977 un bien volé en 1964 ou 1965. En d'autres termes, un acheteur, et surtout un acheteur aussi informé que ce groupement, ne peut jamais invoquer sa bonne foi, notamment s'il a omis de s'informer sur les origines du bien. Enfin, la CEDH s'oppose directement à une pratique des grands musées américains, particulièrement réticents à l'égard des restitutions.
Certes, la décision est une victoire des défenseurs du patrimoine, mais il reste à se demander si elle sera exécutée. N'oublions pas en effet que le Paul Getty Trust a déjà refusé d'appliquer la décision de la Cour de cassation italienne qui, en 2018, affirmait la légalité de la confiscation. On attend avec intérêt la réponse des autorités américaines à la demande de coopération judiciaire formulée par l'Italie pour faire exécuter la décision européenne.
Le droit de propriété : Chapitre 6 du manuel sur internet