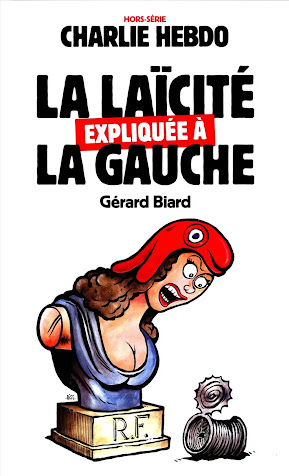La disposition contestée est l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Il est ainsi rédigé : "Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et
régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide
juridictionnelle". On en déduit, à première lecture, que les
étrangers en situation irrégulière ne peuvent pas être admis à ce
bénéfice. Mais ce n'est pas si simple, car l'alinéa 3 de ce même article
3 prévoit que "toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre
exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à
l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement
digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges
prévisibles du procès".
L'aide juridictionnelle
D'emblée, il convient de rappeler que l'aide juridictionnelle est un élément essentiel de l’accessibilité de la justice et qu'elle est présentée comme la mise en oeuvre concrète du droit d'agir en justice, que le Conseil constitutionnel considère comme fondé sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, depuis sa décision du 9 avril 1996. Le droit d'accès à un tribunal est également garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et consacré par la CEDH depuis son arrêt Airey de 1979. Quant au Conseil d'État, il n'a pas hésité à affirmer, dans un arrêt du 10 janvier 2001, que les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d’exercer un recours".
De manière très concrète, l'aide juridictionnelle assure la prise en charge par l’État d’une
partie des frais de justice des requérants dont les revenus sont inférieurs à
un plafond de ressources fixé par la loi. Il est cependant dérogé à cette règle en matière pénale. Toute
personne a, dès la garde à vue, droit à l’assistance gratuite d’un avocat
commis d’office, dès lors qu’elle en fait la demande, quel que soit le montant
de ses ressources. Les étrangers en situation irrégulière bénéficient donc de l'assistance d'un avocat devant le juge pénal.
En l'espèce, le contentieux relève du droit du travail. Le Conseil a été saisi de trois QPC par des étrangers en situation irrégulière qui travaillaient dans la même entreprise de ramassage des poubelles. Tous souhaitaient saisir la juridiction des Prud'hommes pour obtenir la transformation en contrat à durée indéterminée (CDI) des multiples contrats d'intérim ou à durée déterminée qui leurs avaient été successivement imposés par leur employeur. On se doute bien que leur salaire ne leur permettait guère de s'offrir les services d'un avocat, et ils ont donc demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en vain dans la plupart des cas. Seul un seul d'entre eux a vu sa demande satisfaite, exception très éclairante sur le caractère arbitraire du droit en vigueur, jusqu'à l'annulation par le Conseil.
En effet, on l'a vu, l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi de 1991 prévoit une exception au principe d'exclusion des étrangers en situation irrégulière lorsque "leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès". Dans l'affaire ayant suscité les trois QPC, il y avait au départ quatre requérants devant les Prud'hommes. Sur les quatre, trois se sont vu refuser l'aide juridictionnelle, et un l'a obtenue, ce qui explique qu'il ne soit pas partie à la QPC.
Le problème est que la décision d'octroi ou de refus est prise par le Bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) placé auprès de chaque tribunal judiciaire. Composé de différentes personnalités qualifiées, il a le statut juridique d'une simple commission administrative. Surtout, il n'a pas à motiver ses décisions. L'avocat saisi reçoit simplement un formulaire administratif mentionnant que l'aide à été accordée, et ce document est, avant tout, un justificatif lui permettant de percevoir sa rémunération. Il est donc concrètement impossible de savoir pour quels motifs la situation de l'un des quatre requérants a été considérée comme "digne d'intérêt", justifiant donc l'aide juridictionnelle et pour quels motifs elle a été refusée aux trois autres. Tous ne s'étaient pas adressés au même BAJ, et on est autorisé à déduire que les critères d'attribution sont différents à Créteil et à Nanterre.
Le principe d'égalité devant la justice
Dès lors, la décision du Conseil constitutionnel était parfaitement prévisible. Il annule la disposition constituée en affirmant qu'elle porte atteinte au principe d'égalité devant la justice. Certes il reconnait que "le législateur peut prendre des dispositions spécifiques à l’égard des étrangers, en tenant compte notamment de la régularité de leur séjour", principe qu'il avait déjà posé dans sa décision du 13 août 1993. Mais c’est à la condition d’assurer des garanties égales à tous les justiciables. La notion de "situation digne d'intérêt" est bien trop floue pour justifier une telle rupture d'égalité.
Cette décision ne suscite pas réellement la surprise. Il était déjà entendu que les étrangers en situation irrégulière bénéficiaient d'un certain nombre de droits, parmi lesquels la liberté du mariage garantie par la même décision du 13 août 1993. Mais si les étrangers en situation irrégulière ont le droit de se marier, ils doivent aussi avoir celui de divorcer, procédure dans laquelle il est obligatoire d'être représenté par un avocat. En matière de droit du travail, le législateur prévoit, dans les articles L 8252-1 et L 8252-2 du code du travail, que le salarié en situation irrégulière "est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code". Et il ajoute que les Prud'hommes peuvent être saisis pour imposer à l'employeur le respect de ses obligations. C'est précisément ce qu'on fait les auteurs des QPC, et l'aide juridictionnelle apparaît ainsi indissociable du droit d'accès à un tribunal.
Sur le fond, il faut bien constater que les arguments soulevés pour défendre le texte étaient particulièrement faibles. La disposition litigieuse avait d'ailleurs été intégrée dans la loi par un amendement sénatorial dont la justification reposait sur l'idée qu'interdire l'aide juridictionnelle aurait pour effet de dissuader l'immigration irrégulière. Un tel effet était bien peu probable. Aujourd'hui, les défenseurs du texte devant le Conseil se sont bornés à affirmer que ce refus d'aide juridictionnelle n'empêchait pas l'étranger en situation irrégulière d'avoir accès au juge, à ses frais. Les commentateurs, quant à eux, ont évidemment mis en avant le coût d'une telle mesure, puisque l'aide juridictionnelle est financée par les deniers de l'État.
C'est parfaitement exact, mais il faudrait aussi se demande pourquoi cette annulation intervient presque huit ans après la loi qui a introduit dans l'ordre juridique une disposition assez grossièrement anticonstitutionnelle. La longueur de ce délai s'explique peut-être par le caractère quantitativement marginal des contentieux civils et du travail auxquels sont parties des étrangers en situation irrégulière. Ils sont plutôt concernés, quantitativement, par les recours contre les mesures d'éloignement et par les poursuites pénales qui, dans les deux cas, ne sont pas concernées par ces dispositions. Les commentateurs dénoncent ainsi une décision qui, selon eux, offre aux étrangers en situation irrégulière l'aide juridictionnelle, alors, que, pour la plupart des contentieux qui les concernent, ils en disposaient déjà.
Il resterait à se demander pourquoi des entreprises ayant pignon sur rue recrutent des étrangers en situation irrégulière pour vider les poubelles. La réponse est peut être dans la question... prioritaire de constitutionnalité. Ils les recrutent pour pouvoir leur faire signer des contrats précaires et sous-payés, en pensant qu'ils ne pourront pas se plaindre devant les Prud'hommes, justement parce qu'ils sont précaires et sous-payés. Hélas, désormais, ils pourront se plaindre.