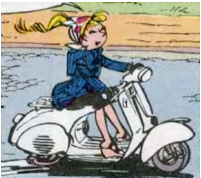L'Assemblée plénière de la Cour de cassation déclare, dans un arrêt du 7 novembre 2022, que le refus de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone aux forces de police durant une garde à vue constitue, en soi, une infraction distincte de celle pour laquelle la personne était poursuivie.
Les faits à l'origine de l'affaire constituent le lot quotidien d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Une personne, arrêtée en possession de stupéfiants, est placée en garde à vue. Elle refuse alors de communiquer le code de ses deux téléphones, dont on soupçonne qu'ils sont utilisés dans le cadre d'un trafic de drogue. L'intéressé est certes condamné pour les faits liés à ce trafic, mais une seconde condamnation est également prononcée. Celle-là repose sur l'article 434-15-2 du code pénal qui punit de trois ans d'emprisonnement de 270 000 € le fait de refuser de remettre aux autorités judiciaires "la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit". Dans l'hypothèse où cette remise aurait pu permettre d'éviter la commission d'une infraction, la peine est portée à cinq ans et 450 000 € d'amende.
Nature juridique du code de déverrouillage
Pour le requérant, le code de déverrouillage de son téléphone ne s'analyse juridiquement pas comme une "convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie", et ne saurait donc fonder l'infraction prévue à l'article 434-15-2 du code pénal. L'article 29 al. 1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique donne une définition du "moyen de cryptologie" comme "tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, à l'aide de conventions secrètes (...). Ces moyens de cryptologie visent principalement à garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité". La définition est intéressante mais ne nous éclaire pas vraiment sur son application, ou non, au code d'un téléphone.
Le tribunal correctionnel a relaxé le requérant, ce qui a immédiatement suscité un appel du parquet. La Cour d'appel de Douai a pourtant confirmé la relaxe, considérant que le code n'est pas une « convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie » . A ses yeux, il ne sert pas à décrypter des données, mais seulement à débloquer l'écran d'accueil pour, ensuite, accéder aux données. Ce saucissonnage de l'opération n'a pas été apprécié par la Chambre criminelle qui a cassé l'arrêt le 13 octobre 2020, renvoyant l'affaire à Douai. Mais la cour d'appel a persévéré dans son interprétation, et dans la décision de relaxe du requérant, suscitant cette fois l'intervention de l'Assemblée plénière.
L'arrêt du 7 novembre 2022 a donc pour effet d'imposer aux juges du fond une toute autre définition de la « convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ». Pour l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le code de déverrouillage de l'écran d'accueil constitue une « convention de déchiffrement", si précisément son activation a pour effet de mettre au clair les données cryptées que contient l'appareil, ou auxquelles il est susceptible de donner accès. Or, il est évident qu'aujourd'hui la plupart des smartphones permettent d'accéder à un ensemble considérable de données, par exemple celles figurant sur le Cloud géré par l'utilisateur.
Cette analyse technique est renforcée par l'usage délictueux qui peut être fait d'un smartphone. Celui-ci peut en effet être utilisé pour gérer un trafic de drogues, prendre les commandes, communiquer avec les clients, gérer les stocks, voire surveiller en réseau l'activité policière du quartier. En d'autres termes, l'ouverture du smartphone grâce au code permet aux forces de police de prouver la préparation ou la commission d'une infraction. De fait, pour la Cour, la personne qui refuse de communiquer son code peut être poursuivie et condamnée sur le fondement de l'article 434-15-2 du code pénal.
Cette résistance de la cour d'appel avait, en l'espèce, quelque chose d'un combat d'arrière-garde.
Un combat d'arrière-garde
Elle n'allait guère dans le sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans sa décision QPC du 30 mars 2018, M. Malek B., il déclare constitutionnelles les dispositions de l'article 434-15-2 du code pénal. D'une part, il estime qu'elles poursuivent des objectifs de valeur constitutionnelle que sont la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs. D'autre part, le Conseil observe que l'obligation de donner le code de verrouillage d'un téléphone n'emporte aucune présomption de culpabilité et que l'opération n'a pas pour objet d'obtenir des aveux. Il s'agit seulement de déchiffrer des données cryptées qui figurent déjà sur un support.
De même, l'article 434-15-2 du code pénal ne saurait être considéré comme contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment au droit au juste procès garanti par son article 6. Il n'entraine en effet aucune atteinte aux droits de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, principes déjà affirmés par la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 décembre 2019.
La décision rendue le 7 novembre 2022 témoigne ainsi de l'évolution de la perception juridique de cet étrange instrument qu'est le téléphone. A une époque pas si lointaine, il n'était que le vecteur de conversations privées, et il semblait logique qu'elles soient couvertes par le secret de la correspondance, sans pour autant être à l'abri des investigations judiciaires, voire des écoutes administratives. Aujourd'hui, le smartphone a une fonction bien plus large. S'il demeure un outil de conversations privées, il est aussi un second bureau, un espace de conservation de données, un accès à l'internet mondial. A ce titre, il n'est pas illogique qu'il soit ouvert aux investigations, à une forme nouvelle de perquisitions. En d'autres termes, nous ne parlons plus vraiment dans notre téléphone. C'est le téléphone qui parle pour nous.
La garde à vue : Chapitre 4 Section 2 § & B du manuel sur internet