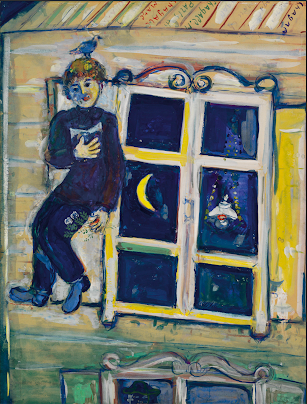L'usage
veut qu'à l'occasion des vacances, Liberté Libertés Chéries invite ses
lecteurs à retrouver les grands textes sur les libertés publiques. Pour
comprendre le droit d'aujourd'hui, pour éclairer ses principes
fondamentaux et comprendre les crises qu'il traverse, il est nécessaire
de lire ou de relire ceux qui en ont construit le socle historique et
philosophique. Les courts extraits proposés n'ont pas d'autre objet que
de susciter une réflexion un peu détachée des contingences de
l'actualité, et de donner envie de lire la suite. Bien
entendu, les lecteurs de Liberté Libertés Chéries sont invités à
participer à cette opération de diffusion de la pensée, en faisant leurs
propres suggestions de publication. Qu'ils en soient, à l'avance,
remerciés.
Aujourd'hui, LLC propose à ses lecteurs la très célèbre lettre adressée par Jules Ferry aux instituteurs le 17 novembre 1883, dans la seconde année d'application de la loi du 28 mars 1882.
Jules Ferry
Lettre aux instituteurs
17 novembre 1883
L'écolier. Chagall. 1925
Monsieur l’Instituteur,
L’année scolaire qui vient de s’ouvrir sera la seconde année d’application
de la loi du 28 mars 1882. Je ne veux pas la laisser commencer
sans vous adresser personnellement quelques recommandations
qui sans doute ne vous paraîtront pas superflues
après la première année
d’expérience que vous venez de faire du régime nouveau.
Des diverses obligations qu’il vous impose,
celle assurément qui vous tient le plus à cœur,
celle qui vous apporte le plus lourd surcroît
de travail et de souci,
c’est la mission qui vous est confiée de donner à vos élèves
l’éducation morale et l’instruction civique :
vous me saurez gré de répondre à vos
préoccupations en essayant de bien fixer le caractère
et l’objet de ce nouvel enseignement ;
et, pour y mieux réussir, vous me permettrez
de me mettre un instant à votre place, afin de vous montrer,
par des exemples empruntés au
détail même de vos fonctions,
comment vous pourrez remplir à cet égard
tout votre devoir et rien que votre devoir.
La loi du 28 mars se caractérise
par deux dispositions qui se complètent
sans se contredire :
d’une part, elle met en dehors du programme obligatoire
l’enseignement de tout dogme particulier,
d’autre part elle y place au
premier rang l’enseignement moral et civique.
L’instruction religieuse
appartient aux familles et à l’église,
l’instruction morale à l’école.
Le législateur n’a donc pas entendu
faire une œuvre purement négative.
Sans doute il a eu pour premier objet
de séparer l’école de l’église,
d’assurer la liberté de conscience
et des maîtres et des élèves, de
distinguer enfin deux domaines
trop longtemps confondus,
celui des croyances qui sont personnelles, libres et variables,
et celui des connaissances qui sont communes et indispensables à tous.
Mais il y a autre chose dans la loi du 28 mars :
elle affirme la volonté de fonder chez nous une éducation nationale
et de la fonder sur des notions du devoir et du droit
que le législateur n’hésite pas
à inscrire au nombre des premières vérités
que nul ne peut ignorer. Pour cette partie capitale de l’éducation, c’est sur vous,
Monsieur, que les pouvoirs publics ont compté.
En vous dispensant de l’enseignement religieux,
on n’a pas songé à vous décharger de l’enseignement moral :
c’eût été vous enlever ce qui fait la dignité de votre profession.
Au contraire, il a paru tout naturel que l’instituteur,
en même temps qu’il apprend aux enfants à lire et à écrire,
leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale
qui ne sont pas moins universellement acceptées
que celles du langage et du calcul.
En vous conférant de telles fonctions,
le Parlement s’est-il trompé ?
A-t-il trop présumé de vos forces,
de votre bon vouloir, de votre compétence ?
Assurément il eût encouru ce reproche s’il
avait imaginé de charger
tout à coup quatre-vingt mille instituteurs
et institutrices d’une sorte de cours ex professo sur les principes,
les origines et les fins dernières de la morale.
Mais qui jamais a conçu rien de semblable ?
Au lendemain même du vote de la loi, le Conseil
supérieur de l’instruction publique a pris soin de vous expliquer
ce qu’on attendait de vous, et il l’a fait en des termes
qui défient toute équivoque.
Vous trouverez ci-inclus un exemplaire
des programmes qu’il a approuvés
et qui sont pour vous le plus
précieux commentaire de la loi :
je ne saurais trop vous recommander
de les relire
et de vous en inspirer.
Vous y puiserez la réponse aux
deux critiques opposées qui vous parviennent.
Les uns vous disent :
« Votre tâche d’éducateur moral est impossible à remplir. »
Les autres :
« Elle est banale et insignifiante. »
C’est placer le but
ou trop haut ou trop bas.
Laissez-moi vous expliquer
que la tâche n’est ni
au-dessus de vos forces ni au-dessous de votre estime,
qu’elle est très limitée et pourtant d’une très
grande importance ; extrêmement simple,
mais extrêmement difficile.
J’ai dit que votre rôle en matière d’éducation morale
est très limité. Vous n’avez à enseigner à proprement parler rien de
nouveau, rien qui ne vous soit familier comme à tous les honnêtes gens.
Et quand on vous parle de mission et d’apostolat,
vous n’allez pas vous y méprendre : vous n’êtes point
l’apôtre d’un nouvel évangile ;
le législateur n’a
voulu faire de vous ni un philosophe,
ni un théologien improvisé. Il ne vous
demande rien qu’on ne puisse
demander à tout homme
de cœur et de sens. Il est impossible
que vous voyiez chaque jour tous ces enfants
qui se pressent autour de vous,
écoutant vos leçons, observant votre conduite,
s’inspirant de vos exemples,
à l’âge où l’esprit s’éveille, où le cœur s’ouvre,
où la mémoire s’enrichit,
sans que l’idée vous vienne aussitôt de profiter de
cette docilité, de cette confiance,
pour leur transmettre, avec
les connaissances scolaires proprement dites,
les principes mêmes
de la morale, j’entends simplement de cette bonne
et antique
morale que nous avons reçue de nos pères
et que nous nous honorons tous de suivre dans les relations de la vie
sans nous mettre en peine d’en discuter les bases philosophiques. Vous
êtes l’auxiliaire et, à certains égards, le suppléant du père de
famille ; parlez donc à son enfant comme vous voudriez que l’on parlât
au vôtre ; avec force et autorité, toutes les fois qu’il s’agit d’une
vérité incontestée, d’un précepte de la morale commune ; avec la plus
grande réserve, dès que vous risquez d’effleurer un sentiment religieux
dont vous n’êtes pas juge.
Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu’où il vous est
permis d’aller dans votre
enseignement moral,
voici une règle pratique à laquelle vous
pourrez vous tenir : avant de proposer à vos élèves
un précepte, une maxime
quelconque, demandez-vous s’il se trouve,
à votre connaissance, un seul honnête homme
qui puisse être froissé de ce que vous allez dire.
Demandez-vous si un père de famille, je dis
un seul, présent à votre classe
et vous écoutant, pourrait de
bonne foi refuser son assentiment
à ce qu’il vous entendrait dire. Si oui,
abstenez-vous de le dire ; sinon, parlez
hardiment, car ce que vous allez communiquer
à l’enfant, ce n’est pas votre propre sagesse, c’est la
sagesse du genre humain,
c’est une de ces idées d’ordre universel que plusieurs
siècles de civilisation ont fait entrer dans le
patrimoine de l’humanité. Si étroit que
vous semble, peut-être, un cercle d’action
ainsi tracé, faites-vous un devoir
d’honneur de n’en jamais sortir, restez en deçà de
cette limite plutôt que de vous
exposer à la franchir : vous ne toucherez jamais
avec trop de scrupule à cette
chose délicate et sacrée, qui est la conscience
de l’enfant.
Mais une fois que vous vous êtes ainsi
loyalement enfermé dans l’humble
et sûre région de la morale usuelle, que vous
demande-t-on ?
Des discours ?
Des dissertations savantes ?
De brillants exposés,
un docte enseignement ?
Non, la famille et la société vous
demandent de les aider à bien
élever leurs enfants, à en faire des
honnêtes gens. C’est dire qu’elles
attendent de vous non des
paroles, mais des actes, non pas
un enseignement de plus à
inscrire au programme,
mais un service tout pratique que vous
pourrez rendre au pays plutôt
encore comme homme que
comme professeur.
Il ne s’agit plus là d’une série de vérités à démontrer mais,
ce qui est tout autrement laborieux, d’une longue suite
d’influences morales à exercer sur de jeunes êtres, à
force de patience, de fermeté, de douceur, d’élévation
dans le caractère et de puissance
persuasive. On a compté sur
vous pour leur apprendre à bien vivre par la manière même
dont vous vivez avec eux et devant eux. On a osé prétendre
pour vous à ce que d’ici
quelques générations les habitudes et les idées des
populations au milieu desquelles
vous aurez exercé
attestent les bons effets de vos leçons de morale.
Ce sera dans l’histoire un honneur particulier pour
notre corps enseignant d’avoir mérité d’inspirer aux
Chambres françaises cette opinion, qu’il y a dans
chaque instituteur, dans chaque institutrice, un
auxiliaire naturel du progrès
moral et social, une personne
dont l’influence ne peut manquer en quelque sorte
d’élever autour d’elle le niveau des mœurs. Ce rôle
est assez beau pour que vous n’éprouviez nul besoin
de l’agrandir. D’autres se chargeront plus tard d’achever
l’œuvre que vous ébauchez
dans l’enfant et d’ajouter à
l’enseignement primaire de la morale un complément
de culture philosophique ou religieuse. Pour vous,
bornez-vous à l’office que la société vous assigne
et qui a aussi sa noblesse :
poser dans l’âme des
enfants les premiers et solides
fondements de la simple moralité.
Dans une telle œuvre, vous le savez, Monsieur,
ce n’est pas avec des difficultés de théorie et de haute
spéculation que vous avez à vous mesurer ; c’est avec
des défauts, des vices, des préjugés grossiers. Ces
défauts, il ne s’agit pas de les condamner — tout le
monde ne les condamne-t-il pas ? — mais de
les faire disparaître par une succession de petites
victoires obscurément remportées.
Il ne suffit donc
pas que vos élèves aient compris et retenu vos leçons,
il faut surtout que leur caractère s’en ressente :
ce n’est pas dans l’école, c’est surtout hors de
l’école qu’on pourra juger ce qu’a
valu votre enseignement. Au reste, voulez-vous en juger vous-même
dès à présent et voir si votre enseignement est
bien engagé dans cette voie, la seule bonne :
examinez s’il a déjà conduit vos élèves à quelques
réformes pratiques. Vous leur avez parlé, par
exemple, du respect dû à la loi : si cette leçon
ne les empêche pas, au sortir de la classe, de
commettre une fraude, un acte, fût-il léger, de contrebande
ou de braconnage, vous n’avez
rien fait encore ; la leçon de morale n’a pas porté. Ou bien vous leur avez expliqué ce que c’est que
la justice et que la vérité : en sont-ils assez
profondément pénétrés pour aimer mieux avouer une
faute que de la dissimuler par un
mensonge, pour
se refuser à une indélicatesse ou à un passe-droit
en leur faveur ?
Vous avez flétri l’égoïsme et fait l’éloge du
dévouement : ont-ils, le moment d’après, abandonné
un camarade en péril pour ne songer
qu’à eux-mêmes ? Votre leçon
est à recommencer. Et que ces rechutes ne vous découragent pas.
Ce n’est pas l’œuvre d’un jour de former ou
de réformer une âme libre. Il y faut beaucoup
de leçons sans doute, des lectures, des
maximes écrites, copiées, lues et relues ; mais il y faut
surtout des exercices pratiques, des efforts, des
actes, des habitudes. Les enfants ont en morale un
apprentissage à faire, absolument comme pour la
lecture ou le calcul. L’enfant qui sait reconnaître et
assembler des lettres ne sait pas encore lire ; celui
qui sait les tracer l’une après l’autre ne sait pas écrire.
Que manque-t-il à l’un et à l’autre ?
La pratique, l’habitude,
la facilité, la rapidité et la sûreté de l’exécution.
De même, l’enfant qui répète les premiers
préceptes de la morale
ne sait pas encore se conduire :
il faut qu’on l’exerce à les
appliquer couramment, ordinairement, presque d’instinct ;
alors seulement la morale aura passé de son esprit dans son cœur,
et elle passera de là dans sa vie ;
il ne pourra plus la désapprendre.
De ce caractère tout pratique de l’éducation morale à l’école
primaire, il me semble facile de tirer les règles qui doivent
vous guider dans le choix de vos
moyens d’enseignement.
Une seule méthode vous permettra d’obtenir les
résultats que nous souhaitons. C’est celle que le
Conseil supérieur vous a recommandée : peu de
formules, peu d’abstractions, beaucoup d’exemples
et surtout d’exemples pris sur le vif de la réalité.
Ces leçons veulent un autre ton, une autre allure
que tout le reste de la classe, je ne sais quoi de plus
personnel, de plus intime, de plus grave. Ce n’est
pas le livre qui parle, ce n’est
même plus le fonctionnaire,
c’est pour ainsi dire le père de famille
dans toute la
sincérité de sa conviction et de son sentiment.
Est-ce à dire qu’on puisse vous demander de
vous répandre en une sorte d’improvisation
perpétuelle sans aliment et sans appui du dehors ?
Personne n’y a songé, et, bien loin de vous manquer,
les secours extérieurs qui vous sont offerts ne
peuvent vous embarrasser que par leur richesse
et leur diversité. Des philosophes et des publicistes,
dont quelques-uns comptent parmi les plus
autorisés de notre temps et de notre pays, ont
tenu à honneur de se faire vos collaborateurs,
ils ont mis à votre disposition ce que leur doctrine
a de plus pur et de plus élevé. Depuis quelques mois,
nous voyons grossir presque de semaine en semaine
le nombre des manuels d’instruction morale et civique.
Rien ne prouve mieux le prix que l’opinion publique
attache à l’établissement d’une forte culture
morale par l’école primaire. L’enseignement laïque
de la morale n’est donc estimé ni impossible,
ni inutile, puisque la mesure décrétée par le législateur
a éveillé aussitôt un si puissant écho dans le pays.
C’est ici cependant qu’il importe de distinguer de
plus près entre l’essentiel et l’accessoire,
entre l’enseignement moral qui est
obligatoire, et les moyens
d’enseignement qui ne le sont pas. Si quelques
personnes, peu au courant de la pédagogie moderne,
ont pu croire que nos livres
scolaires d’instruction morale et civique
allaient être une sorte de catéchisme nouveau,
c’est là une erreur
que ni vous, ni vos collègues, n’avez pu commettre. Vous
savez trop bien que, sous le régime
de libre examen et de libre concurrence qui est le droit commun
en matière de librairie classique,
aucun livre ne vous arrive imposé
par l’autorité universitaire. Comme tous
les ouvrages que vous employez,
et plus encore que tous les
autres, le livre de morale est
entre vos mains un auxiliaire et rien de
plus, un instrument dont
vous vous servez sans vous y asservir.
Les familles se méprendraient sur le
caractère de votre
enseignement moral si elles pouvaient
croire qu’il réside
surtout dans l’usage exclusif d’un livre même excellent.
C’est à vous de mettre la vérité
morale à la portée de
toutes les intelligences, même de celles qui n’auraient
pour suivre vos leçons le secours d’aucun manuel ;
et ce sera le cas tout d’abord
dans le cours élémentaire.
Avec de tout jeunes enfants qui commencent
seulement à lire, un manuel spécial de morale
et d’instruction civique serait manifestement
inutile. À ce premier degré, le Conseil supérieur
vous recommande, de préférence à l’étude
prématurée d’un traité quelconque, ces causeries
familières dans la forme, substantielles au fond,
ces explications à la suite des lectures et des
leçons diverses, ces mille prétextes que vous offrent
la classe et la vie de tous les jours pour
exercer le sens moral de l’enfant.
Dans le cours moyen, le manuel n’est autre
chose qu’un livre de lectures qui s’ajoute
à ceux que vous possédez déjà.
Là encore, le Conseil, loin de vous prescrire
un enchaînement rigoureux de doctrines,
a tenu à vous laisser libre de varier vos procédés
d’enseignement : le livre n’intervient que pour
vous fournir un choix tout fait de bons exemples,
de sages maximes et de récits qui
mettent la morale en action.
Enfin, dans le cours supérieur,
le livre devient surtout un utile moyen de réviser,
de fixer et de coordonner ; c’est comme
le recueil méthodique des principales idées qui
doivent se graver dans l’esprit du jeune homme.
Mais, vous le voyez, à ces trois degrés,
ce qui importe, ce n’est pas l’action
du livre, c’est la vôtre. Il ne faudrait
pas que le livre vînt en quelque sorte
s’interposer entre vos élèves et vous,
refroidir votre parole, en émousser
l’impression sur l’âme de vos élèves,
vous réduire au rôle de simple répétiteur
de la morale. Le livre est fait pour
vous, non vous pour le livre. Il est votre
conseiller et votre guide, mais c’est vous qui devez rester le guide et le conseiller par
excellence de vos élèves.
Pour vous donner tous les moyens de nourrir
votre enseignement personnel de la substance
des meilleurs ouvrages, sans que le hasard
des circonstances vous enchaîne exclusivement
à tel ou tel manuel, je vous envoie la liste
complète des traités d’instruction morale et
civique qui ont été, cette année, adoptés
par les instituteurs dans les diverses académies ;
la bibliothèque pédagogique du chef-lieu de
canton les recevra du ministère, si elle ne les
possède déjà, et les mettra à votre disposition.
Cet examen fait, vous restez libre ou de
prendre un de ces ouvrages pour en faire un
des livres de lecture habituelle de la classe ;
ou bien d’en employer concurremment
plusieurs, tous pris, bien entendu, dans
la liste générale ci-incluse ; ou bien
encore, vous pouvez vous réserver
de choisir vous-même,
dans différents auteurs, des extraits destinés
à être lus, dictés, appris. Il est juste
que vous ayez à cet égard autant de liberté
que vous avez de responsabilité. Mais
quelque solution que vous préfériez,
je ne saurais trop vous le redire, faites
toujours bien comprendre que vous
mettez votre amour-propre, ou plutôt votre
honneur, non pas à faire adopter tel ou tel livre,
mais à faire pénétrer
profondément dans les jeunes
générations l’enseignement pratique des
bonnes règles et des bons sentiments.
Il dépend de vous, Monsieur, j’en ai
la certitude, de hâter par votre manière
d’agir le moment où cet enseignement
sera partout non seulement accepté,
mais apprécié, honoré, aimé, comme
il mérite de l’être. Les populations
mêmes dont on a cherché à exciter
les inquiétudes ne résisteront pas
longtemps à l’expérience qui se fera
sous leurs yeux. Quand elles vous
auront vu à l’œuvre, quand elles
reconnaîtront que vous n’avez d’autre
arrière-pensée que de leur rendre
leurs enfants plus instruits et meilleurs,
quand elles remarqueront que vos
leçons de morale commencent à produire
de l’effet, que leurs enfants rapportent de
votre classe de meilleures habitudes, des
manières plus douces et plus respectueuses,
plus de droiture, plus d’obéissance, plus de goût
pour le travail, plus de soumission au devoir,
enfin tous les signes d’une incessante amélioration
morale, alors la cause de l’école laïque sera
gagnée, le bon sens du père et le cœur de la
mère ne s’y tromperont pas, et ils n’auront pas besoin qu’on leur apprenne ce qu’ils vous
doivent d’estime, de confiance et de gratitude.
J’ai essayé de vous donner, Monsieur,
une idée aussi précise que possible d’une
partie de votre tâche qui est, à certains
égards, nouvelle, qui de toutes est la
plus délicate ; permettez-moi d’ajouter
que c’est aussi celle qui vous laissera
les plus intimes et les plus
durables satisfactions. Je serais heureux
si j’avais contribué par cette lettre à vous
montrer toute l’importance qu’y attache
le gouvernement de la République et si je
vous avais décidé à redoubler d’efforts pour
préparer à notre pays une génération de bons citoyens.
Recevez, Monsieur l’instituteur,
l’expression de ma considération distinguée.
Le Président du Conseil,
Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,
Jules Ferry.